Les députés français s’apprêtent à voter une loi qui pourrait marquer un tournant dans la régulation des PFAS, ces substances chimiques surnommées “polluants éternels”. La proposition de loi (PPL), défendue par le député écologiste Nicolas Thierry, prévoit une interdiction progressive de ces composés dans plusieurs secteurs industriels, bien au-delà des normes européennes en vigueur. Une ambition saluée par les ONG, mais qui interroge scientifiques et industriels : la France va-t-elle trop loin, trop vite, au risque d’un préjudice économique et technologique ?
La France en croisade contre les PFAS : pragmatisme ou excès de zèle ?
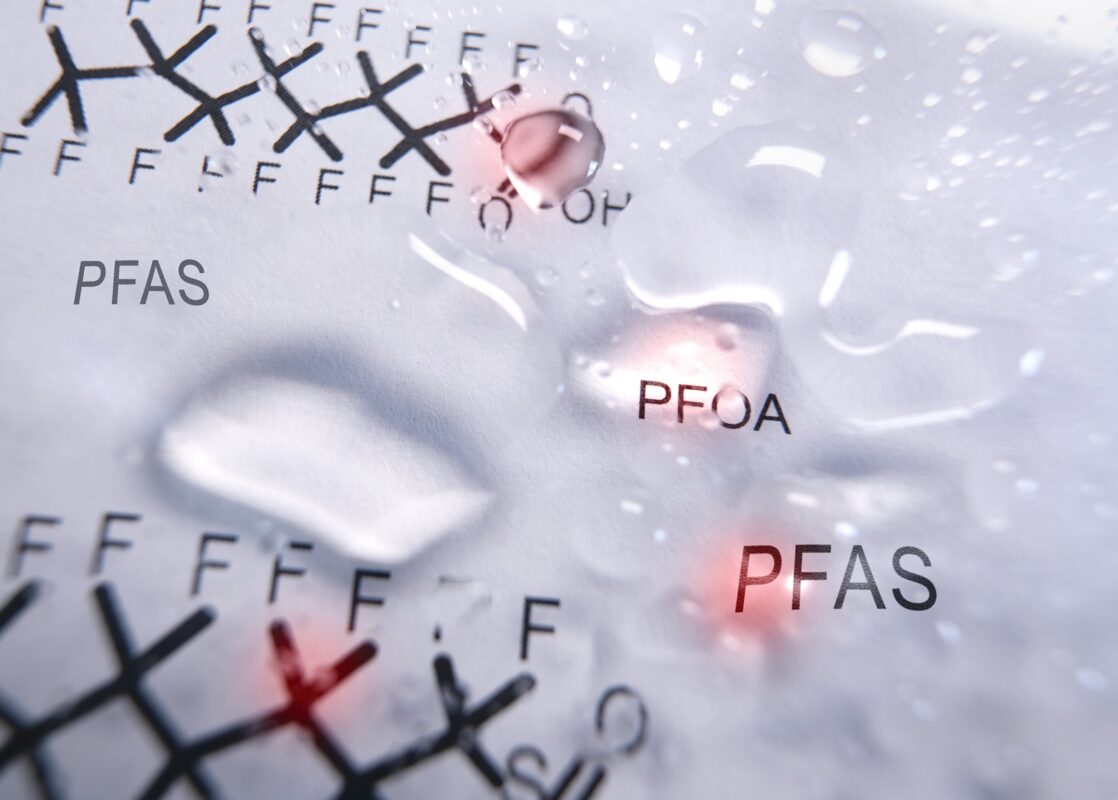
Les PFAS : une chimie aux mille visages
Derriere l’acronyme PFAS se cache une famille de plus de 4 700 composés chimiques, aux propriétés exceptionnelles de résistance à l'eau, aux graisses et à la chaleur. Utilisés depuis les années 1950, ils sont omniprésents : mousses anti-incendie, textiles imperméables, batteries, électronique de pointe... Mais leur stabilité fait aussi leur dangerosité : certains PFAS s’accumulent dans l’environnement et l’organisme, avec des conséquences sanitaires inquiétantes. L’OMS et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) les associent à des troubles hormonaux, des cancers et des effets nocifs sur le système immunitaire.
Toutefois, tous les PFAS ne sont pas à mettre dans le même sac. Certains, comme le perfluorooctane sulfonate (PFOS) et l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), sont déjà très encadrés. D’autres, comme les fluoropolymères de longue chaîne, sont jugés inertes et sans impact significatif sur la santé ou l’environnement. La communauté scientifique plaide donc pour une régulation ciblée, plutôt qu’un bannissement généralisé.
L’Europe, un cadre déjà contraignant
L’Union européenne n’a pas attendu la France pour agir. Dès 2006, les PFOS ont été interdits. En 2020, les PFOA ont été restreints via le règlement REACH. En 2023, cinq pays européens (Allemagne, Suède, Pays-Bas, Danemark et Norvège) ont proposé une interdiction élargie, avec des exemptions pour les usages jugés indispensables. L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) doit trancher d’ici 2025.
Mais la France, elle, veut aller plus loin. La PPL prévoit une interdiction progressive : dès 2026, les PFAS seront bannis des textiles, cosmiques et imperméabilisants. En 2030, tous les textiles contenant des PFAS seront concernés, sauf ceux destinés à la sécurité et à la défense. Un calendrier plus strict que celui envisagé par Bruxelles.
Un risque pour l’industrie française ?
L’intention est louable, mais le coup de balai français pourrait s’accompagner d’effets pervers. D’abord économique : les industries de l’aéronautique, de l’automobile ou du textile technique, dépendantes des PFAS, alertent sur des pertes de compétitivité face aux acteurs étrangers. Car si la France interdit, qu’en est-il des importations ? Faudra-t-il accepter sur le marché français des produits étrangers contenant des PFAS interdits en France ? Un risque de distorsion de concurrence qui n’a rien d’anodin.
Ensuite, scientifique : interdire tous les PFAS sans distinction, c’est faire abstraction des avancées technologiques et des alternatives encore en développement. Il faut du temps pour identifier et fabriquer des substituts sûrs et efficaces selon les chercheurs en chimie des matériaux. Or, certaines applications ne disposent pas encore de solutions de remplacement viables.
Un impact limité sur la pollution globale
Enfin, d’un point de vue environnemental, l’efficacité de cette interdiction générale pose question. Car si la France agit seule, le reste du monde ne suit pas forcément. Les États-Unis, la Chine et la Russie continuent d’utiliser d’anciens PFAS, plus toxiques que ceux aujourd’hui réglementés en Europe. La pollution mondiale ne s’arrêtera pas aux frontières françaises. D’autant que les PFAS, par leur persistance, continueront d’exister dans l’environnement pendant des décennies.
La PPL anti-PFAS est-elle donc un pas nécessaire ou une fuite en avant ? Entre précaution sanitaire et pragmatisme industriel, la question demeure. L’Europe travaille à une interdiction adaptée, basée sur des analyses scientifiques. La France, elle, veut prendre de l’avance. Quitte à faire cavalier seul.
