La question des arrêts de travail suscite une attention croissante des pouvoirs publics. L’allongement de leur durée moyenne, les motifs invoqués et l’impact sur les équilibres sociaux et économiques mobilisent désormais les acteurs institutionnels, les partenaires sociaux et les organismes d’assurance.
Les arrêts maladie en forte augmentation
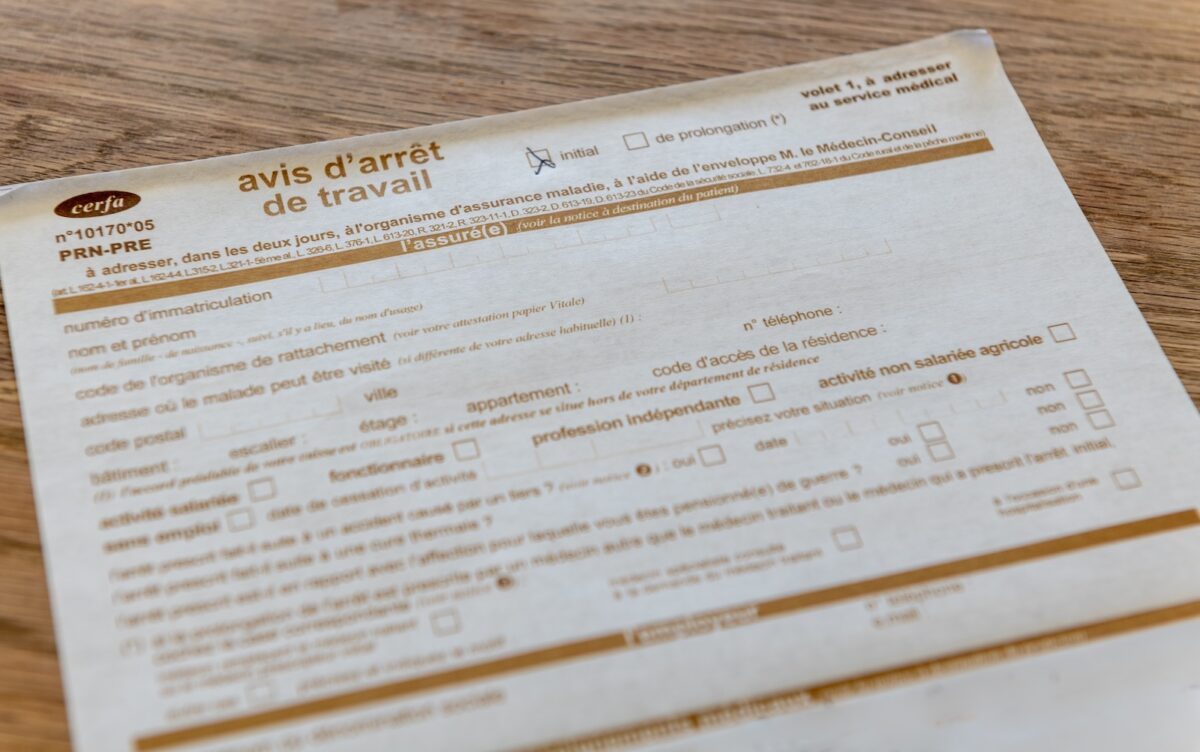
Le 9 avril 2025, plusieurs publications spécialisées ont mis en lumière une tendance confirmée depuis plusieurs années : les arrêts de travail s’allongent de manière continue en France. La durée moyenne des arrêts maladie a atteint 21,5 jours en 2024, contre 18,4 jours deux ans plus tôt, selon les données recueillies par des assureurs et institutions sectorielles. Cette progression ne semble pas conjoncturelle mais durable, entraînant des effets notables sur les dispositifs de prévoyance et les finances de la sécurité sociale.
En parallèle, la proportion d’arrêts de longue durée (dépassant 90 jours) dépasse désormais la moitié du volume total. Un phénomène qui, tout en s’inscrivant dans un contexte d’évolution des pratiques médicales et professionnelles, interpelle sur les capacités d’adaptation du système de protection sociale.
Les facteurs de l’allongement des arrêts : une convergence de causes médicales, sociales et organisationnelles
L’analyse des causes invoquées révèle une pluralité de facteurs. La maladie dite « ordinaire » demeure la première origine d’arrêt, incluant notamment les affections saisonnières ou bénignes. Toutefois, des motifs comme la fatigue persistante, les troubles musculo-squelettiques ou les risques psychosociaux sont de plus en plus souvent mentionnés.
Plusieurs enquêtes signalent que la fatigue est aujourd’hui l’une des justifications les plus fréquentes avancées par les salariés, traduisant une évolution des critères de reconnaissance de la souffrance au travail. Les jeunes générations, en particulier les moins de 34 ans, sont fortement représentées dans les arrêts courts, et une part non négligeable d’entre eux admet avoir eu recours à un arrêt sans pathologie grave.
La structuration des arrêts selon les âges et les genres met aussi en évidence des disparités : les femmes sont surreprésentées parmi les bénéficiaires, et les salariés de plus de 50 ans, s’ils sont minoritaires en volume, concentrent une part importante des dépenses en raison de durées plus longues et de salaires plus élevés.
Un impact budgétaire qui motive un recentrage des politiques publiques
Cette évolution a des conséquences financières majeures. Le montant total des indemnités journalières versées a progressé de 5,4 % entre 2022 et 2023, selon une étude conjointe de la Drees et de l’Assurance maladie. Cette hausse s’explique à la fois par le vieillissement des bénéficiaires et par la revalorisation des rémunérations, les indemnités étant calculées sur le salaire de référence.
Face à cette trajectoire, les pouvoirs publics ont initié une série de mesures destinées à encadrer le dispositif. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a acté une baisse du plafond de calcul des indemnités journalières versées par la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam), passant de 1,8 à 1,4 fois le SMIC. Cette modification réduit le montant maximum versé par jour et vise à contenir la dépense publique.
En parallèle, l’Assurance maladie prévoit d’intensifier le suivi des prescriptions, en accompagnant les professionnels de santé dans l’évaluation de la nécessité des arrêts, tout en renforçant les mécanismes de contrôle en cas d’abus supposés.
Les régimes de prévoyance complémentaire sous pression
L’allongement des arrêts affecte également les régimes de prévoyance collective. Ces dispositifs, qui permettent de compléter les prestations légales, sont sous tension. Les assureurs constatent une hausse des demandes d’indemnisation, notamment sur les arrêts longs, et anticipent des ajustements tarifaires, voire des révisions contractuelles.
Les employeurs, tenus de maintenir partiellement les salaires en fonction de l’ancienneté du salarié, voient également leur exposition budgétaire s’accroître. En l’absence de mécanismes de mutualisation renforcée, cette pression pourrait entraîner des arbitrages défavorables, notamment pour les entreprises de petite taille.
Disparités d’accès aux protections et inégalités sociales face à l’arrêt
Tous les salariés ne sont pas exposés de la même manière aux arrêts ni couverts avec le même niveau de protection. Les travailleurs précaires, intérimaires, saisonniers, salariés à temps partiel ou employés de particuliers, disposent rarement d’une couverture complémentaire suffisante pour compenser la baisse de revenu induite par un arrêt. Pour ces catégories, l’arrêt maladie devient rapidement un facteur de fragilité économique.
Le télétravail, souvent présenté comme un levier de continuité d’activité, atténue partiellement le recours à l’arrêt, mais son accès reste limité à certains secteurs ou fonctions. Une étude récente montre qu’il permettrait d’éviter un arrêt dans deux cas sur trois pour les télétravailleurs, mais ce potentiel d’amortissement reste inégalement réparti.

