La communauté scientifique alerte depuis plusieurs années sur les effets sanitaires d’une alimentation ultra-transformée. Une nouvelle étude relance le débat, avec des chiffres inquiétants. Au cœur des enjeux : la capacité des États à réguler un marché très rentable, mais aux conséquences de plus en plus visibles.
L’impact de l’alimentation industrielle sur la santé se précise
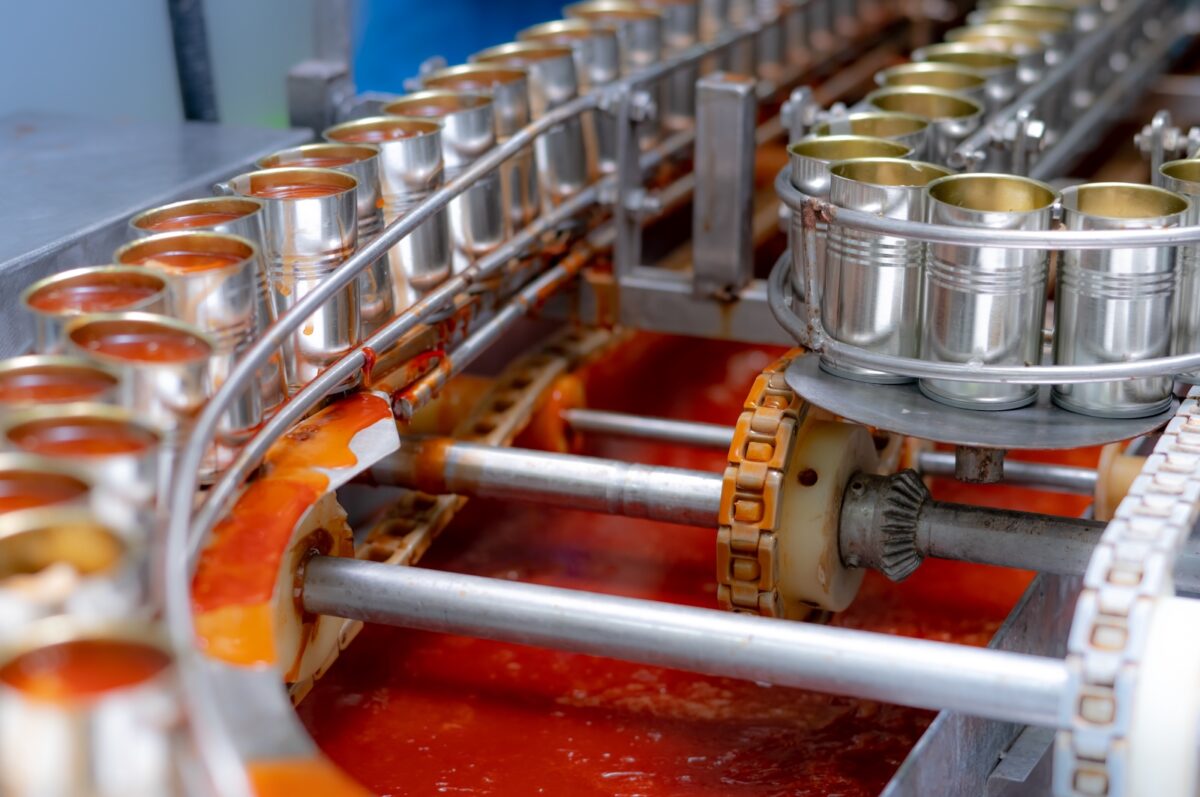
Le 29 avril 2025, la revue scientifique The American Journal of Preventive Medicine a publié une étude coordonnée par une équipe de chercheurs internationaux, évaluant l’impact de la consommation d’aliments ultra-transformés sur la mortalité prématurée. L’analyse, fondée sur les données de près de 240 000 adultes répartis dans huit pays, établit une association statistique significative entre la part d’aliments ultra-transformés dans l’alimentation quotidienne et le risque de décès toutes causes confondues.
Selon l’étude, une augmentation de 10 % de la consommation de ces produits serait associée à une hausse de 2,7 % du risque de mortalité prématurée. Si cette relation reste de nature corrélationnelle, sa récurrence dans des contextes géographiques et sociaux variés donne du poids à l’hypothèse d’un lien structurel entre transformation industrielle de l’alimentation et dégradation de la santé publique.
Les pays étudiés (États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, Mexique, Chili, Brésil et Colombie) ont été choisis en fonction de leurs profils de consommation. Les résultats révèlent des écarts notables : les États-Unis, où les aliments ultra-transformés représentent une part importante de l’apport énergétique, affichent un taux de mortalité attribuable à ces produits estimé à 14 %, contre moins de 4 % en Colombie.
Les limites de l’intervention publique en matière de nutrition
Cette publication scientifique vient s’ajouter à un corpus croissant de recherches sur les risques liés aux produits ultra-transformés. Si la documentation s’étoffe, les réponses institutionnelles restent disparates. Plusieurs pays, dont la France, disposent déjà de recommandations nutritionnelles ciblant indirectement ces produits. Cependant, rares sont ceux à avoir adopté des mesures réglementaires spécifiques.
Le débat politique porte notamment sur l’opportunité de classer ces aliments dans une catégorie à part, soumise à des contraintes marketing ou fiscales. À ce jour, les politiques publiques privilégient des approches informatives : étiquetage nutritionnel simplifié, campagnes de sensibilisation, promotion des circuits courts. L’hypothèse d’une taxation différenciée en fonction du degré de transformation est régulièrement évoquée, mais peu appliquée.
En France, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (ANSES) recommande depuis plusieurs années de limiter la consommation d’aliments transformés, sans pour autant imposer de cadre normatif précis à leur présence dans l’offre commerciale. La marge de manœuvre reste donc en grande partie entre les mains du consommateur.
Un secteur économique stratégique et peu encadré
Derrière la question sanitaire, se pose celle de l’équilibre entre liberté de production, sécurité alimentaire et régulation des marchés. Les aliments ultra-transformés sont produits par un nombre restreint d’acteurs industriels, aux capacités logistiques et commerciales considérables. Ils constituent une part essentielle de la chaîne agroalimentaire mondiale, notamment en matière d’exportation et de grande distribution.
Leur succès s’explique en partie par leur prix attractif, leur longue durée de conservation et leur praticité d’usage. Dans certains territoires, ils représentent l’essentiel de l’offre alimentaire accessible aux foyers les plus modestes. Toute mesure de restriction soulève donc des enjeux économiques et sociaux complexes, qui expliquent en partie la prudence des pouvoirs publics.
Plusieurs chercheurs mettent en avant cette difficulté à concilier impératifs de santé publique et contraintes industrielles. La priorité donnée à la compétitivité économique empêche souvent une remise à plat des logiques de production. Pour d’autres, il s’agit d’un choix politique assumé, révélateur des rapports de force entre institutions sanitaires, ministères économiques et groupes industriels.
Une approche graduée plutôt qu’une réforme frontale
La stratégie actuellement privilégiée dans les pays à haut revenu repose sur une logique incitative. Elle vise à orienter les comportements alimentaires sans imposer de contraintes fortes aux producteurs. Cette approche s’inscrit dans un cadre plus large, incluant la lutte contre l’obésité, la prévention des maladies chroniques et la réduction des inégalités de santé.
Toutefois, les effets de ces politiques demeurent difficiles à évaluer à court terme. En l’absence de consensus sur la définition réglementaire des aliments ultra-transformés, les instruments juridiques restent limités. La classification NOVA, utilisée par la plupart des études scientifiques, n’a pas de valeur contraignante en droit européen ou français.
Plusieurs experts, notamment au sein de l’OMS et d’agences sanitaires nationales, recommandent une harmonisation des définitions et des outils de mesure afin de permettre une action publique plus structurée. Ce travail normatif est encore en cours, ce qui contribue à ralentir l’émergence de politiques plus contraignantes.
Des arbitrages politiques à venir à propos de l'alimentation
La publication de cette nouvelle étude devrait relancer les débats au sein des institutions européennes et nationales, notamment dans le cadre de la stratégie « De la ferme à la table » (Farm to Fork) portée par la Commission européenne. Cette stratégie, qui vise à rendre le système alimentaire européen plus durable, inclut des objectifs en matière de nutrition et de santé.
En France, les prochaines réformes de la politique alimentaire devront intégrer ces données scientifiques, tout en tenant compte des réalités économiques du secteur agroalimentaire. La question d’un encadrement spécifique des produits ultra-transformés pourrait figurer à l’agenda des discussions parlementaires liées à la prochaine loi de santé publique.
En attendant, le débat se poursuit entre défenseurs d’une approche volontariste fondée sur la régulation et partisans d’un modèle basé sur la responsabilité individuelle et l’autorégulation du marché.

